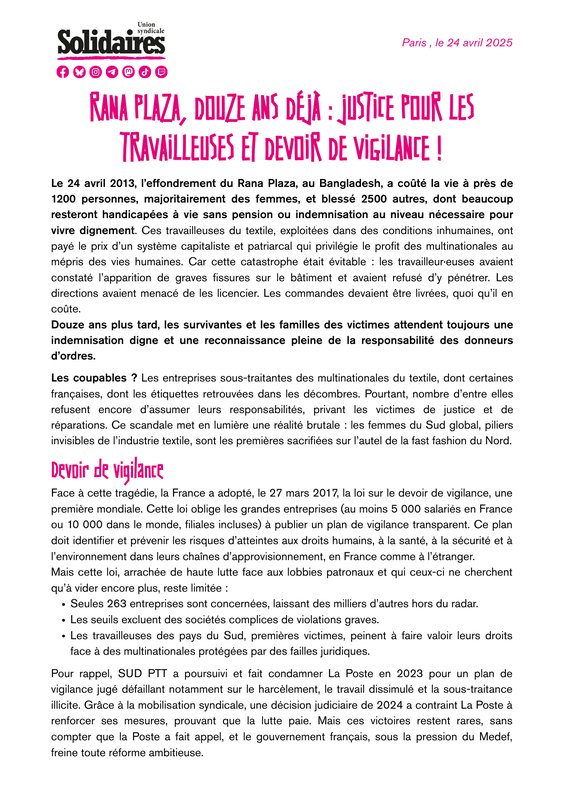Le 24 avril 2013, l’effondrement du Rana Plaza, au Bangladesh, a coûté la vie à près de 1 200 personnes, majoritairement des femmes, et blessé 2 500 autres, dont beaucoup resteront handicapées à vie sans pension ou indemnisation au niveau nécessaire pour vivre dignement. Ces travailleuses du textile, exploitées dans des conditions inhumaines, ont payé le prix d’un système capitaliste et patriarcal qui privilégie le profit des multinationales au mépris des vies humaines. Car cette catastrophe était évitable : les travailleur·euses avaient constaté l’apparition de graves fissures sur le bâtiment et avaient refusé d’y pénétrer. Les directions avaient menacé de les licencier. Les commandes devaient être livrées, quoi qu’il en coûte.
Douze ans plus tard, les survivantes et les familles des victimes attendent toujours une indemnisation digne et une reconnaissance pleine de la responsabilité des donneurs d’ordres.
Les coupables ?
Les entreprises sous-traitantes des multinationales du textile, dont certaines françaises, dont les étiquettes retrouvées dans les décombres. Pourtant, nombre d’entre elles refusent encore d’assumer leurs responsabilités, privant les victimes de justice et de réparations. Ce scandale met en lumière une réalité brutale : les femmes du Sud global, piliers invisibles de l’industrie textile, sont les premières sacrifiées sur l’autel de la fast fashion du Nord global.
Devoir de vigilance
Face à cette tragédie, la France a adopté, le 27 mars 2017, la loi sur le devoir de vigilance, une première mondiale. Cette loi oblige les grandes entreprises (au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde, filiales incluses) à publier un plan de vigilance transparent. Ce plan doit identifier et prévenir les risques d’atteintes aux droits humains, à la santé, à la sécurité et à l’environnement dans leurs chaînes d’approvisionnement, en France comme à l’étranger.
Mais cette loi, arrachée de haute lutte face aux lobbies patronaux et qui ceux-ci ne cherchent qu’à vider encore plus, reste limitée :
- Seules 263 entreprises sont concernées, laissant des milliers d’autres hors du radar.
- Les seuils excluent des sociétés complices de violations graves.
- Les travailleuses des pays du Sud, premières victimes, peinent à faire valoir leurs droits face à des multinationales protégées par des failles juridiques.
Pour rappel, SUD PTT a poursuivi et fait condamner La Poste en 2023 pour un plan de vigilance jugé défaillant notamment sur le harcèlement, le travail dissimulé et la sous-traitance illicite. Grâce à la mobilisation syndicale, une décision judiciaire de 2024 a contraint La Poste à renforcer ses mesures, prouvant que la lutte paie. Mais ces victoires restent rares, sans compter que la Poste a fait appel, et le gouvernement français, sous la pression du Medef, freine toute réforme ambitieuse.
Vers une vigilance européenne ?
Il y a un an, le 24 avril 2024, le Parlement européen a adopté la directive sur le devoir de vigilance en matière de durabilité (CSDDD). Publiée le 5 juillet 2024, elle impose aux entreprises de l’UE (plus de 1 000 salariés et 450 millions d’euros de chiffre d’affaires) de prévenir les violations des droits humains et environnementaux, y compris dans leurs chaînes d’approvisionnement mondiales. Elle inclut des sanctions (jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires) et un plan de transition climatique, une exigence absente de la loi française.
Mais cette directive, bien que prometteuse, a été affaiblie par des compromis. La France, sous l’influence du patronat, a tenté de la bloquer en 2024, arguant qu’elle nuirait à la compétitivité. Et le texte risque encore d’être affaibli par la directive Omnibus.
Douze ans après l’effondrement du Rana Plaza, l’Union syndicale Solidaires refuse l’oubli.
L’Union syndicale Solidaires exige :
- Une loi française élargie à toutes les entreprises, sans exception, pour protéger les droits des travailleuses et des travailleurs partout dans le monde.
- Une application rigoureuse de la directive européenne, avec des sanctions dissuasives et des mécanismes accessibles aux victimes.
- La fin à l’exploitation des populations du Sud global pour les profits des multinationales.
Le combat pour le devoir de vigilance est celui des femmes qui cousent nos vêtements, des communautés dévastées par l’extractivisme, des générations futures menacées par la crise climatique.
C’est un combat pour les conditions de travail de l’ensemble des travailleurs et travailleuses à travers le monde. C’est pourquoi l’Union syndicale Solidaires appelle l’ensemble des travailleurs et travailleuses à se mobiliser le 28 avril partout sur le territoire pour la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail et le 1er mai.