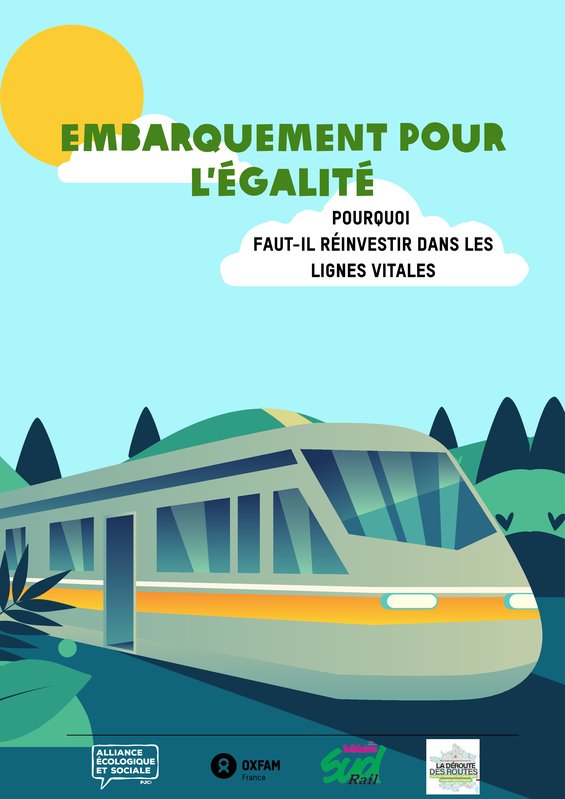Rapport d'Oxfam avec l'Alliance écologique et sociale, SUD Rail et La Déroute des routes
Retrouvez le rapport complet en pièce jointe.
La transition écologique ne se résume pas à réduire les émissions : elle doit aussi être une transition sociale, garantissant à chacune et chacun la possibilité de se déplacer. Se déplacer conditionne l’accès à l’emploi, à la formation, aux soins et à la vie sociale ; pourtant, accéder aux modes de déplacement reste marqué par de fortes inégalités sociales et territoriales. En France, la dépendance structurelle à la voiture individuelle, héritée de décennies de politiques centrées sur le développement du réseau routier et des grandes lignes à grande vitesse, a conduit à une situation de “précarité de mobilité” – notion définie par la chercheuse Audrey Berry comme la limitation des déplacements essentiels liée à la combinaison de revenus insuffisants et de facteurs structurels (faible offre de transports collectifs, véhicules énergivores, hausse des prix de l’énergie). Cette situation concerne un·e Français·e sur quatre.
Cette dépendance a des conséquences économiques directes : plus de 20 % du revenu des ménages modestes est aujourd’hui consacré aux déplacements, contre 14 % pour l’ensemble des ménages. L’absence d’alternatives crédibles enferme de nombreux habitant·es, notamment dans les zones rurales et périurbaines, dans une mobilité contrainte, coûteuse ou inexistante. À l’inverse, les données montrent que vivre à proximité d’une gare réduit l’usage de la voiture de 15 %, illustrant le potentiel du ferroviaire comme levier d’équité sociale et territoriale.
Ce rapport démontre que la réduction des inégalités d’accès à la mobilité et la réduction des émissions du secteur des transports reposent sur le développement des modes de transports collectifs.
Et pour illustrer ce constat, l’exemple du réseau ferroviaire de desserte locale est mis en avant. L’état du réseau ferroviaire français révèle un déséquilibre préoccupant : près d’un sixième du réseau ferré français est en fin de vie, et 10 000 km de voies – soit un tiers du réseau – sont menacés de disparition d’ici dix ans. Dès 2028, 4 000 km seront déjà dégradés, impactant 2 000 trains par jour, soit un train sur sept. Ce déclin est d’autant plus marqué pour les lignes dites « de desserte fine du territoire », qui pourtant permettent d'effectuer des déplacements du quotidien, et de diminuer la dépendance à la voiture à de nombreux ménages.
Cette situation n’est pas une fatalité. Des politiques régionales volontaristes montrent qu’une offre attractive et régulière peut transformer les usages. En Occitanie, par exemple, la mise en place d’une tarification accessible (trajets à 1 € le week-end) et d’horaires étendus a entraîné une hausse de 68 % de la fréquentation TER entre 2019 et 2024, bien au-dessus de la moyenne nationale. Ce succès témoigne de besoins massifs et non couverts sur l’ensemble du territoire, confirmant que la demande pour une mobilité durable et abordable est forte dès lors que l’offre est adaptée.
Au-delà des enjeux d’équité, la relance du ferroviaire constitue un levier stratégique pour atteindre les objectifs climatiques nationaux. Depuis plus de vingt-cinq ans, le secteur des transports demeure la première source d’émissions de gaz à effet de serre en France, représentant 34 % du total national en 2023. Le train, pour sa part, assure 10 % des déplacements pour seulement 0,3 % des émissions. Cependant, sans investissements rapides, ces gains potentiels sont menacés : le vieillissement du réseau, combiné aux effets du changement climatique (inondations, vagues de chaleur, incendies), fragilise la résilience d’un service public essentiel.
Le rapport plaide ainsi pour une réévaluation du rôle du train du quotidien, en le considérant comme une infrastructure de cohésion nationale, couplée à des services de transports collectifs adaptés à chaque territoire. Un financement à hauteur des besoins, de 3 milliards d’euros supplémentaires par an, est nécessaire pour moderniser le réseau, sécuriser les dessertes locales et garantir un accès équitable à la mobilité sur l’ensemble du territoire.